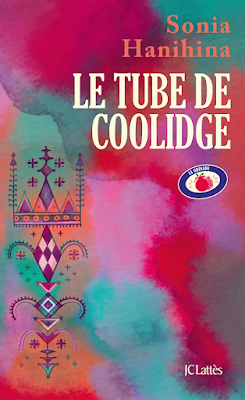Dracula
Bram Stoker,
Ed Callidor, 18/10/2024, 576 pages
Après avoir vu le film de Luc
Besson, inspiré de l’œuvre de Bram Stoker, j’ai eu envie de relire le roman,
ma première lecture datant de trente ans. J’avais alors un excellent souvenir
de cette lecture.
Heureux Hasard, on m’avait
fait pour Noël, ce beau cadeau : Dracula illustré, roman intégral avec
lettres manuscrites, coupures de presse, et autres documents dactylographiés.
Un livre magnifique !
Si j’ai apprécié cette
relecture, surtout au début, je dois avouer que je ressors mitigée de la
seconde lecture, non pour une question de qualité du roman, j’ai un profond
respect pour le travail de Bram Stoker, mais parce que j’ai trouvé que ce
récit avait beaucoup vieilli.
Je vais donc distinguer ce que
j’ai aimé : le contenu, et ce qui m’a moins plu : le style, les pratiques scientifiques balbutiantes
qui laissent perplexes, qui passaient à l’époque et ne sont pas recevables aujourd’hui
et qui donnent à ce roman un aspect vieilli.
Concernant le contenu, même si
aujourd’hui l’horreur n’a plus de limite, elle semblait savamment dosée en 1897,
suffisamment pour impressionner le lectorat de l’époque, rappelons que l’affaire
Jack l’éventreur hantait encore les esprits, et un monstre sanguinaire tel que
le conte de Dracula avait son effet. Il faut dire que le suspens est de mise et
la pression étudiée pour monter progressivement, l’auteur se montrant très
généreux en allusions dès le début, sans jamais écrire le mot « vampire »
auquel il préfère le terme de « non-mort »(Nosferatu). Les
protagonistes sont placés face à une maladie inconnue, montrent une certaine
naïveté en décrivant certains symptômes, ce qui peut faire sourire le lecteur
tout en l’effrayant, car il sait, lui, de quoi il retourne, c’est ce qui m’a
captivée en début de roman.
Concernant le contenu également,
il faut reconnaître que Dracula est une référence : les signes de
reconnaissance du vampire n’ont pas changé, et je pense qu’il est judicieux de
lire ce roman si l’on veut asseoir ses connaissances à ce sujet.
Le style m’a quelque peu
ennuyée, à tel point que je me suis demandé comment, alors que j’étais beaucoup
plus jeune, j’ai pu poursuivre cette lecture riche de dialogues s’étalant
sur la vie, le bien, le mal, la société, les considérations philosophiques, les
éternelles congratulations des héros qui n’en finissent pas de se féliciter, d’être
en admiration les uns pour les autres, en partie pour justifier la volonté de
tuer le monstre venu perturber ce monde de bisounours, et par politesse. Il est
vrai que le docteur Van Helsing mérite le respect car il est celui sans lequel
aucune action n’aurait été entreprise, personnage dévoué à la cause de ses
amis.
Quelques scènes par ailleurs,
m’ont surprise parce que je les ai accueillies avec mon regard du XXIème siècle :
les épisodes de transfusion font donc sourire, la notion de groupe sanguin n’est
pas connue et au regard du nombre de transfusions reçues de quatre personnes au
même receveur, il n’est logiquement pas possible d’assurer sa survie, ça passe
en 1897, pas aujourd’hui. On assiste également, dans la deuxième moitié du
récit, à une intervention avec trépanation, sur un homme aux blessures
multiples, sans mesures d’hygiène sans bloc dans sa cellule, peut être suis-je
pointilleuse, mais cela peut paraître énorme si on sort du contexte de l’Angleterre
victorienne.
J’ai beaucoup apprécié la
montée du suspens, le décalage entre les intentions de Helsing et de ses
assistants et les faits réels, la poursuite du vampire jusqu’à l’assaut final.
Ce roman restera pour moi et
beaucoup de lecteurs, une œuvre majeure, un incontournable.